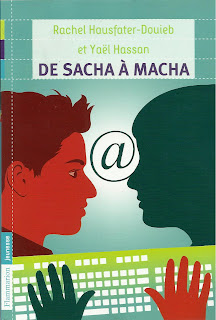J'avais réussi, à la disparition de Philippe Makita, à recueillir le témoignage de quelques hommes de lettres : Matondo Kubu Ture, Apollinaire Singou Basseha, Jean-Blaise Bilombo Samba et Noël Kodia, qui acceptèrent volontiers de s'exprimer, rendant ainsi un bel hommage à celui qui fut leur ami.
MATONDO KUBU TURE (sociologue et écrivain) :
« Philippe Makita : un écrivain secret »
Ce titre, Philippe ne l’aurait pas aimé. Il aurait critiqué avec bonhomie : il n’était pas un polémiqueur né. Il aurait fait remarquer, en kituba, avec l’accent de Dolisie : « Toi aussi, c’est quelle marque ça, où tu vas toujours chercher tes histoires-là ! »
Si l’expression « écrivain secret » est trop forte, je suis prêt à la remplacer par « écrivain qui travaillait tranquillement et calmement ». Encore que… j’utilise le verbe « travailler » en insistant sur l’idée de s’appliquer intensément à une tâche, tout en prenant le temps de ne laisser transpirer aucune information susceptible d’avertir la galerie… Tiens Philippe est actuellement en train de finir son deuxième roman !
Il donnait toujours l’impression qu’il avait l’éternité devant lui, tout le temps de mûrir les fruits de son écriture. S’il était un affairiste invétéré, comme on en voit sur la place, aujourd’hui , Philippe serait l’écrivain congolais le plus publié. En une année, en 2003, il a publié, tour à tour, une anthologie, un recueil de poèmes, un roman, au grand mutisme des médias.
Il fit paraître son premier recueil de poèmes Les Sandales retournées en 1978, aux Éditions Saint-Germain-des-Prés. Il a fallu attendre près d’un quart de siècle, pour retrouver son nom dans les librairies. En 2003, justement il nous gratifia de la Nouvelle Anthologie de la littérature congolaise en collaboration avec Jean-Baptiste Tati Loutard.
Ses tiroirs sont encore remplis de nouvelles, de romans de pièces de théâtre auxquels il travaillait quotidiennement. Quand je le traitais de maniaco-perfectionniste, il répondait avec son éternel sourire : « Nous ne sommes pas des gens du show-business ; une écriture authentique doit arriver au point où elle respire à jamais la paix et le silence » (je fais l’effort de restituer fidèlement ses mots à lui).
Je ne sais pas s’il faisait lire ses manuscrits à son entourage, peut-être à Sylvain Bemba, à Letembet-Ambily, peut-être à Tati Loutard ou à Maxime N’debeka, à ceux de notre génération, j’en doute. Pourtant c’est souvent avec les gens de sa génération qu’il discutait littérature, la poésie en premier lieu. Il se sentait toujours enfant des poètes, une filiation qu’il n’abandonnait jamais, même quand il écrivait des textes que le monde appelle roman ou nouvelle, tel que Le Pacte des contes (2003)
Il avait un secret : la patience de croire à la beauté, comme un apaisement universel que l’on ne peut obtenir qu’au bout d’une longue corvée intelligente.
« Noue à ton front l’anneau de mon intelligence
Et tends-moi tes sandales
Précède-là à l’Orient et reviens sur tes pas
Alors, la lune se réveillera dans tes bras »
(Les Sandales retournées, 1978)
Écrivain doublé d’un critique littéraire, il adorait parler des œuvres des autres. Il connaissait tout ce que les Congolais et les Congolaises faisaient paraître, gardant la plupart de ses propres écrits dans la tranquillité des tiroirs. Si un jour, tous ses livres étaient publiés, je serai le premier à m’écrier : « Quelle chance d’avoir connu cet écrivain-là ! »
Apollinaire SINGOU-BASSEHA (écrivain et éditeur) :
« Philippe Makita : une mission inachevée »
Il m’est très difficile de témoigner pour un ami avec qui j’ai une longue amitié, un parcours d’écrivain irréprochable, un frère de plume qui, toute sa vie, n’a cessé de se battre pour le rayonnement de la littérature congolaise, un frère « qui bat sur terre le tam-tam fécond/de la force et de la dignité » pour reprendre quelques mots de son recueil Les Sandales retournées. Nul n’ignore qu’en Afrique, le tam-tam annonce toujours une nouvelle. Bonne ou mauvaise.
Lorsque le 27 août 2006, j’apprends la nouvelle de la disparition de Philippe, je suis resté estomaqué : quelques jours auparavant, nous avions mangé ensemble avec Alain Mabanckou, venu à Brazzaville prendre part à la première édition des « Rencontres du livre vivant ». Je me suis dit : « Pourquoi cette fatalité ? Et pourquoi un à un nous, écrivains, quittons cette terre à la pointe des pieds ? En commençant par Tchicaya U Tam’Si, Sony Labou Tansi, Sylvain Bemba, Amélia Nene, Alice Valette, Didier Kounkou-Lareis, Bernard Zoniaba, Serge Bourra dit Ma Kandet, Antoine Letembet-Ambily… »
Par son activité littéraire, Philippe Makita avait, sans conteste, un avenir prometteur. Il publie en 1978 Les Sandales retournées (Éditions Saint-Germain-des-Prés), en 1982, une étude critique intitulée « L’Étrange destin de Wangrin d’Amadou Hampaté Bâ ». Il participe à L’Anthologie des littératures francophones d’Afrique centrale. En 2003, il publie Femme, mon paysage aux Éditions Acoria et un roman Le Pacte des contes aux Éditions La Bruyère. Philippe Makita s’était promis de publier, tous les deux ans, un nouveau livre. Il est dommage que cet « amoureux des belles lettres », cet « individu pluriel » qui constituait « une force et une dignité » de notre horizon littéraire n’ait pas achevé sa mission.
Sa rencontre avec Jean-Baptiste Tati Loutard aura symbolisé un pont jeté entre deux générations, la réactivation d’un enthousiasme, le rappel de la responsabilité pour notre génération de prendre en charge le destin de notre littérature. La preuve ? Leur Nouvelle anthologie de la littérature congolaise, un travail minutieux entrepris par des regards complices et croisés. À ce propos, je me souviens de la réponse de Philippe au cours d’un entretien qu’il m’a accordé le 22 septembre 2003 lors de la présentation de cet ouvrage : « Une anthologie est une œuvre sélective. Ça veut dire qu’il faut absolument faire un choix, il faut faire des sacrifices. Ça n’a pas été facile ».
La disparition de Philippe Makita laisse un grand vide dans les lettres congolaises. Philippe avait encore beaucoup de choses à dire et à faire.
Adieu Philippe, mon ami, mon frère de plume !
Noël KODIA (universitaire, écrivain et critique littéraire) :
« MAKITA, un grand poète »
Philippe Makita a été mon collègue à l'Université de brazzaville. C'est là qu’il m'avait parlé de la publication de son premier recueil de poèmes composé de textes écrits presque au lycée. Nous discutions beaucoup de littérature, surtout du théâtre scolaire. Dans les années 70, il écrivit "Les talons de la souffrance" que présenta la troupe théâtrale du Lycée du Drapeau rouge (actuellement lycée Chaminade), où il enseignait le français, pendant que de mon côté j'écrivis "Les conjurés ou la voix de Lumumba", une pièce de théâtre qui retrace le destin du héros congolais avant sa mort.
Nous nous sommes séparés en 1983 quand je vins en France pour mon troisième cycle. De retour au pays, je le retrouvai comme chercheur à l'INRAP où il occupait la fonction de chef des programmes tout en donnant des cours de littérature à l'Université, parce que titulaire d'une Maîtrise de littérature africaine. Nous avons milité à l'UNEAC* jusqu'à mon départ pour la France.
Makita pour moi est un grand poète de la nouvelle génération, qui s'est donné au roman avec "Le Pacte des contes", un récit qui sort de l'ordinaire et qui trace un autre chemin que jusque-là le roman congolais n'avait jamais emprunté. Après Sony Labou Tansi et Henri Lopes, il est le seul à avoir eu le courage de mettre en cause le romanesque linéaire dans lequel se sont embarqués la majorité de ses confrères. Avec Le Pacte des contes s'est ouverte une autre page du roman congolais qui malheureusement se voit vite fermée par la disparition de son auteur.
*UNEAC : Union nationale des écrivains et artistes congolais.
Jean-Blaise BILOMBO SAMBA (poète) :
« Car les sandales se sont retournées pour longtemps. »
La première somme de poésie de Philippe Makita avait pour titre Sandales retournées ; elle avait été saluée comme un nouveau ton, juste et ouvert dans sa proximité avec autrui. Une voix nouvelle se posait là, urgente et sensible, donc digne.
C’est à mon retour de Dakar, en 1990, que ma compagne, Marie-Léontine Tsibinda, m’a présenté Philippe : il était déjà membre de l’équipe d’expertise de l’Inrap. Bien sûr, il avait déjà publié les Sandales retournées dont Edouard Maunick avait fait un compte-rendu élogieux dans mille soleils à Rfi. De ces deux opportunités, démarre ma relation amicale avec Philippe. Nous mettions à profit toutes les opportunités de rencontre pour parler de notre poésie, le destin de notre parole que nous souhaitions lumineuse. Il parlait d’écrire le Livre solaire, une manière poétique de poursuite d’une espérance infinie inversement proportionnelle de la noirceur de la vie nationale.
En novembre 2003, nous avions, Philippe, Matondo Kubu Ture et moi-même partagé le si peu ordinaire désir d’une « rentrée littéraire » autour de la figure de Tati Loutard. Nous portions alors le rêve ouvert et redoutable de tenter de faire exister à nouveau Brazzaville comme un Orient culturel incontournable, créatif et libre. Nous avions préparé cet événement à son domicile avenue des Trois Martyrs, où sa compagne, grande prêtresse, pourvoyait en arachides, tubercules et autres ignames de Djambala, cette religion de nouveaux allumés littéraires en quêtede sacrements inédits. Philippe avait pu obtenir l’aval de Tati. La Nouvelle anthologie de la littérature Congolaise venait de paraître. Nous étions frappés par la disponibilité du monde à notre endroit : un vendredi et un samedi de novembre 2003, la littérature congolaise s’intégrait dans une espérance oubliée depuis Sony Labou Tansi et Sylvain Bemba.
Toujours en 2003, lorsque, je lui ai confié mon idée de constituer un Bureau (une bibliothèque ?) de liaison des poètes dans notre capitale, il s’est emballé et m’a encouragé de toutes ses forces. Il a été l’un des tous premiers à signer sa fiche d’adhésion. Mais comme toujours, je vais très peu au bout des choses et il n’a cessé me chahuter pour cela.
Habitant une discrétion essentielle, Philippe Makita m’a toujours paru un être secret. Eminemment secret. C’est ainsi qu’installé dans l’attente du Livre solaire dont il m’avait tant parlé, j’ai vu arriver, coup sur coup comme des météores, Femme, mon paysage (poésie, 2003) et Le Pacte des contes (roman, 2004). Sûr qu’il a toujours écrit à la frontière du silence, cherchant à atteindre quelque chose qui le dépasse et nous dépasse, quelque chose qui le rende davantage disponible au monde et à l’autre, mieux à la transcendance même. Sinon comment aurait-il jamais eu l’amour d’initier et la patience de faire aboutir la Nouvelle anthologie de la littérature congolaise ? Dans sa discrétion élective, Philippe a élaboré une nouvelle éthique de la relation littéraire fondée sur un rapport intranquille mais digne et respectueux de l’intimité de l’autre dans sa parole et sa confrontation au Comment vivre cher à Tchicaya.
Insoumis mais serein, tel était Philippe. Pas engagé comme moi, mais habité par la teneur de sa responsabilité civique, celle qui imbibe toute son œuvre. C’est en cela que Femme, mon paysage m’apparaît comme un coup de tonnerre dans un ciel tranquille.
Un jour de l’année 2005, discutant avec lui de ma fascination pour le mythe d’Orphée et me plaignant de l’absence de documentation, quelle ne fût ma surprise de le voir revenir de France, à quelques mois de là, le livre d’Edouard Schuré Les Grands Initiés sous les bras. Il n’avait pas oublié ma quête. Or lui, bien avant moi, interrogeait déjà notre sphère de dialogue avec la nature, le cosmos et l’immanence. C’est bien ce que dit Sylvain Bemba qui, parlant de Philippe, convoque Claudel pour qui « …chaque chose ne subsiste pas pour elle seule, mais dans un rapport infini avec toutes les autres… »
Sylvain avait ouvert le domaine de notre rêve en nous dédiant à tous les deux son troisième roman Le Dernier des cargonautes. Cette élection non sollicitée, nous avait, Philippe et moi, installé dans une manière de binaire qui appelait à rechercher en permanence le troisième terme, celui d’une autonomie fraternelle : l’écriture et le sacré, ebale ya bo moyi, un chemin d’eau et de vie pour pagayer vers le grand large tout simplement…
Nous avions encore tant de choses à faire ! Maintenant que les sandales se sont retournées pour longtemps, Philippe nous manque déjà : sa vigilance, son empathie, sa conceptualité littéraire arrimée à la raison citoyenne. Cependant, sa figure et ses mots porteront toujours la contagion d’un univers à explorer afin de nous connaître davantage et nous rendre compatible avec la paix, la beauté et la joie, somme toute, la démocratie d’être.
Témoignages recueillis avec le concours d’André-Patient BOKIBA, Professeur de Lettres à l’Université de Brazzaville.