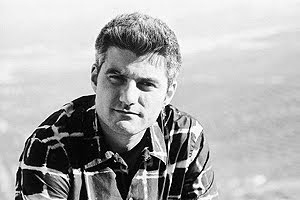Plantons le décor, non, l’intrigue :
Plantons le décor, non, l’intrigue :Un homme est interpellé sur son lieu de travail. Nom : Djeli Diawara. Domicile : foyer surpeuplé. Torts : être en possession de faux papiers. Ceux-ci retirés, il se retrouve à la rue, sans travail, et surtout sans plus de quoi nourrir les siens restés au pays tandis que lui se contentait de survivre. Il suait sang et eau pour gagner son pécule. Il avait également chèrement payé l’acquisition de son titre de séjour. Celui-ci s’avérant faux, le réseau de fabrication de faux papiers est mis au jour, impliquant un boss de la préfecture qui faisait tourner ainsi un business très rentable, avec la complicité de deux autres employés de la préfecture ainsi que celle, incontournable, d’un mafieux africain chargé de repérer la clientèle. Ce dernier est à la tête de plusieurs trafics mêlant drogue, proxénétisme, faux billets etc. L’affaire Djeli Diawara risque de les faire tous sauter, d’autant plus que celui-ci, avec d’autres sans-papiers, des dizaines, squattent l’Eglise Saint-Bernard et décrètent même une grève de la faim, attirant ainsi l’attention du public sur leur sort.
Une fatalité inexplicable s’abat sur Diawara, on veut le faire taire et même disparaître, cela arrangerait les corrompus de la préfecture, leurs complices dans la police ainsi que le boss africain qui serait exempté d’assurer le remboursement de la somme versée par Diawara pour acquérir ses faux papiers, ce dernier y tient. En résumé : l’administration française veut noyer l’affaire ; les Etats africains ne répondant jamais présent lorsqu’il s’agit de leurs rejetons, qui pourrait défendre ces «damnés de la terre » ? C’est là qu’intervient le GROPACAS, le Groupe panafricain d’action et d’assistante. Celui-ci charge Kalogun de démasquer les gros bonnets qui en veulent à Djeli Diawara.
Kalogun, qui a le « visage émacié, masque symbolique des deuils et revers d’un continent mis à genoux » (p.11) va ainsi camper quelques jours au cœur de Château-Rouge, quartier du 18e arrondissement de Paris, lieu de concentration de l’immigration africaine et de ses trafics. Durant son enquête, qui va se révéler ardue et entraînera une succession de meurtres, Kalogun va côtoyer les prostituées, les petits dealers africains, les bars et restaurants du coin que ceux-ci fréquentent et qui nous révèlent des hommes et des femmes qui tentent de donner de la consistance à leur vie, qui tentent de gagner leur vie par les moyens qui sont à leur portée. La vie est dure pour eux et il faut parfois être dur dans la vie pour ne pas sombrer. Langage direct. Coloré. Accrochant.
Tenez, le portrait d’Amina, une prostituée p. 29
« Le buste effilé, vachement disproportionné à l’arrière-train en forme de toboggan, Amina tourneboulait avec sa croupe design ; des amortisseurs naturels selon certains, mais, pour d’autres, pur bidonnage de la Création greffé au reste du bifteck comme pour lui servir de contre-poids. La greluche n’en accordait pas moins la blackitude sur l’essentiel : sa carrosserie magnifiait la toute-puissance des dieux ashanti, suggérait le sex-appeal, attirait le fric. Une épaisse perruque doublait sa carafe de ouistiti. Des gros yeux blancs. Sourire de commande. Amina parlait davantage avec ses mains, ce qui la rendait faussement agressive. » (p. 29)
Un portrait masculin cette fois, celui de Sow Gandja, un dealer plutôt attachant :
« Vingt-cinq balais, un mètre soixante, le squelette maltraité, le zoulou ne payait pas de mine. De son mufle, on ne voyait que les oreilles décollées et les carreaux blancs, des yeux tellement ronds qu’ils ressemblaient aux phares d’une Peugeot 404. Dreadlocks défaites, crasseuses, souvenirs d’un mouvement identitaire noyé dans la drogue, le minus affectait un air d’apache conforté par son langage débile. » (p. 51)
Illustration du langage de Sow Gandja, émaillé de verlan :
« Au Makoumba, on businesse sur le même bureau mon paincon et moi, question de ne pas déboussoler les clients. Dès qu’on raboule, je scotche le brelica sous le reaubu. On ne sait maija avec les starskys. » (p. 65)
Danse et séduction :
« Sow braqua ses phares sur la piste. Une blancharde dansotait seulingue, foutrale dans son one-woman-show ; laissant dans une totale indifférence des spécialistes des acrobaties fessières. La sirène chaloupait déjà sur la piste à leur arrivée.. Kalogun se détourna de la fumelle au constat qu’elle était schlass, et voulut reprendre son briefing. Mais le dealer, fasciné par les balancements lascifs, ignora ses appels du pied. Une autre tentative tournant court, le détective poussa une gueulante, obtenant sur-le-champ l’écoute nécessaire [...] Le dealer, qui n’en pouvait plus de ronger son frein, se leva brusquement pour rejoindre la danseuse solitaire. Manque de pot, la meufe piqua aux waters, l’obligeant à tournailler sur la piste avant de regagner la case départ. [...]
La sirène de nouveau sur la piste, Sow s’affranchit de la tutelle encombrante en sautant sur la piste. « Bisso na Bisso ». Raté. Un titre de groupe Wenge Musica Maison-Mère vibra aussitôt dans les haut-parleurs. Le dealer accorda ses mouvements aux pas claudiquants de « ndômbolo ». Les bras collés au buste, soulevés, repliés dans une synchronisation parfaite avec sa partenaire, il ramollit la carcasse comme s’il allait s’afaisser, renouant illico avec sa forme du tonnerre. Le squelette remué en cadence, devenu cadence, il avança à petits pas boitillants, recula au même rythme, répéta ce va-et-vient désopilant. Sans rudesse. Avec morgue. Puis reprit la phase bras collés-soulevés-repliés. La tête haute et le groin torchant une moue débile, il exécuta une pirouette cocasse, tortilla son popotin merdique. Et poursuivit sa démonstration avec entrain/ Kalogun, bouche bée, dut convenir que le caïd en bambou, à défaut de posséder un métier reconnu, connaissait à fond ses classiques. » (p. 68-71)
Comment répondre aux poulets :
« Vos papiers, s’il vous plaît !
- Qu’est-ce qui cloche ? », protesta l’agent du GROPACAS en s’exécutant.
Le perdreau ignora la question, ouvrit le passeport et se mit à le feuilleter, un œil louchant sur le suspect toutes les trois secondes. [...]
- Vous êtes d’où ?
- C’est écrit sur le doc, grand-chef. [...] je suis de Venda, capitale Thohoyandu.
- Jamais entendu parler. C’est dans quel trou ?
- L’Afrique n’est pas un trou, mais un continent. Très vaste. Avec des forêts où l’on n’y voit goutte en plein jour. Vos stratèges l’ont livrée aux charognards et aux marchands d’arme, qui la saignent à blanc ou la mettent à feu et à sang. Je constate qu’elle a été supprimée dans les cours de géo...
- Ça va pas la tête ? pesta le flic, craignant de ferrailler avec un intello déjanté. Vous sortez de l’hôtel ?
- Vous me voyez fréquenter les putes ?
- Reprenez votre passeport, et dites bien le bonjour sous les cocotiers !
- Ils apprécieront, grand-chef ! » (p. 79-80)
Bon allez, j’arrête avec les extraits, mais je voudrais tellement vous en proposer ! Et puis c’est aussi parce que je n’ai pas envie de quitter l’univers d’Achille Ngoye, quitter ses personnages. Tenez, j’ai une furieuse envie de me rendre au métro Château-Rouge. Je sens que désormais, chaque fois que j’irais y faire mes emplettes de produits exotiques, chaque fois que mes pas me porteront dans les allées de ce marché, je penserai au Ballet noir d Ngoye. J’aimerais tellement voir ce roman adapté au cinéma ! Hééé ! Hooo ! N’y a-t-il pas un réalisateur qui voudrait procurer aux lecteurs qui ont aimé ce roman le plaisir de le voir sur le grand écran ?
Né au Congo Kinshasa en 1944, Achille Ngoye est le premier auteur d’Afrique noire à être publié dans la collection « Série noire » des Editions Gallimard. Il a publié plusieurs romans parmi lesquels Agence Black Bafoussa (1996) et Sorcellerie à Bout Portant (1998), toujours chez Gallimard.
Achille Ngoye, Ballet noir à Château-rouge, Gallimard, 2001.